W Sorbonie i gdzie indziej - Tadeusz Boy-Żeleński (gdzie czytac ksiazki .txt) 📖
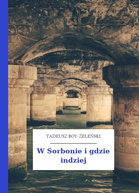
- Autor: Tadeusz Boy-Żeleński
- Epoka: Modernizm
- Rodzaj: Epika
Czytasz książkę online - «W Sorbonie i gdzie indziej - Tadeusz Boy-Żeleński (gdzie czytac ksiazki .txt) 📖». Wszystkie książki tego autora 👉 Tadeusz Boy-Żeleński
C’est bien pénible de n’avoir pas de physionomie homogène. Or, il advint une fois que l’envie me prit de voir clair moi-même dans tout cela, et de chercher ce qu’avaient de commun entre eux ces personnages disparates. La voie d’une confession publique me parut la plus efficace. Et non pas par écrit; non, d’une confession de vive voix. Je fis mes malles, et j’entrepris le voyage dans une cinquantaine de villes en Pologne en y faisant des conférences. Or, il se trouva que cette confession touchait à tout moment aux choses de la France; que c’était en France que j’étais obligé de chercher le sens caché de mes avatars, de sorte qu’en somme, cette confession devint un hymne passionné à la gloire de la France. Mais, lorsque je me permis d’ôter cette robe de bénédictin dont on m’affublait, il me fut impossible de continuer la mystification: je fus contraint de montrer que ce qu’elle cachait, cette robe austère, c’était la passion, l’amour, le plaisir, la volupté.
J’ai été sous le charme de la pensée française presque avant de la connaître; le son de la langue française, la vue d’un livre français, avaient pour moi, enfant, quelque chose de fascinant. Chez nous, en Pologne, dans beaucoup de familles les enfants apprennent le français tôt: pas tout à fait, hélas, comme Montaigne le latin, mais enfin assez tôt. Étant sorti de l’âge des bonnes, j’eus pour maître de français un Courlandais francisé, d’une famille émigrée, un ancien Zouave, qui avait servi la France dans la Légion Étrangère. C’était un solitaire, un misanthrope à la façon d’Alceste, qui vivait au milieu de ses livres, de ses classiques français chéris. Moi, j’étais alors très „moderne” — ce qui est bien naturel, vu que j’avais treize ans — aussi nous nous disputions souvent. Moi, je lui parlais Guy de Maupassant, il me répondait Pascal. Je reconnus plus tard qu’il avait raison. C’était pis, quand il me fit réciter par cœur la description de la grotte de Calypso du Télemaque, en voulant me faire avouer qu’il n’existait rien de plus beau au monde. J’étais alors sous le charme de bien d’autres Calypsos. Le „roman mondain”, qui était alors à son apogée, faisait mes délices; je me bourrais de Cruelles énigmes, de Mensonges, de Notre coeur, de Coeur de femme etc. Gosse de treize ans, avec des mains barbouillées et des pantalons déchirés, je vivais par mon âme dans les coquettes garçonnières des „hommes du monde”, et je couvrais en rêve de baisers brûlants les sveltes, les souples corps de ces „femmes mariées” enchanteresses, qui, après l’heure exquise, s’évadaient discrètement, en laissant après elles une traînée de parfums; je crois que c’était de l’opoponax. Ah! comme je comprenais bien ces „femmes incomprises”, comme j’aurais su les aimer alors! C’était pour moi comme du haschisch, je quittais le livre les joues enflammées, avec une tendresse exaspérée dans l’âme...
Excusez ces détails, peut-être superflus, mais depuis le grand patron de tous ceux qui se confessent, depuis l’immortel Jean-Jacques, une petite description de délires innocents de l’imagination enfantine est devenue, dans une confession, pour ainsi dire de rigueur.
Le collège fini, il fallait embrasser une carrière. J’étais fils d’un artiste, d’un éminent musicien-compositeur, Ladislas Żeleński. Je fus élevé dans l’atmosphère de l’art, pourtant je ne sais quel diable s’en mêla, — quand vint le moment de décider, je choisis la médecine. C’était peut-être encore le dernier écho de l’époque positiviste, qui créa ce préjugé que toute étude un peu sérieuse sur la vie devait commencer par la dissection des cadavres. Mon état d’âme était alors à peu pres celui du fameux Disciple.
Tout en fréquentant assez mollement mes cours, j’avais toujours quelque livre français dans ma poche. Je me passionnais alors pour la critique française, j’adorais Jules Lemaître. C’était aussi le temps de l’épanouissement d’Anatole France. Ah, Mesdames, Messieurs, c’est au Lys rouge que je dus ma première „femme du monde”: ma conversation sur ce livre lui parut si délicate, qu’elle sentit d’instinct qu’elle pouvait se confier à moi.
Je fréquentais, par goût, les jeunes cénacles littéraires à Cracovie. La dévotion était alors aux Scandinaves, aux écrivains russes, à Ibsen, à Strindberg, à Dostoievski, à Nietsche, à Oskar Wilde etc. Nous autres, Polonais, nous avons une grande et belle littérature à nous, mais à l’époque de ma jeunesse nous consommions énormément de littératures étrangères. Or, dans les cénacles d’alors on n’était pas toujours très tendre pour la France. De ce temps je retins comme exemple une anecdote, dont le souvenir m’amuse parfois beaucoup. Un jour, en portant un gros livre sous le bras, j’entrai chez le grand écrivain Przybyszewski, dont j’avais l’honneur d’être le jeune ami. Voyant mon bouquin, toujours curieux des livres, il me demande ce que c’était? C’étaient Les dialogues philosophiques de Renan. A cette vue, l’écrivain fut saisi d’un fou rire; de plus il appela de la chambre voisine sa cuisinière, et, hors de lui, les yeux injectés de sang par le rire convulsif, il lui dit en montrant mon livre: „Kasia, regarde ce que ce monsieur lit!” La cuisinière, un peu hystérique, ne comprenant rien, mais gagnée par la hilarité de son maître, se mit aussi à se tordre de rire; et pendant quelques minutes ils se gaussèrent ainsi tous les deux de ma pitoyable lecture.
Mais, si l’on était quelquefois rebelle au côté rationaliste de la pensée française, en revanche, la poésie française avait conquis les cœurs de notre jeune génération d’alors. Il y a trente ans, nous fumes charmés par la belle traduction faite par le poète Miriam du Bateau ivre d’Arthur Rimbaud, dont on se grisait en le „gueulant” à tue-tête. On admirait Verlaine et on se chuchotait tout bas sa légende; Les fleurs du mal de Baudelaire étaient le livre de chevet de nos jeunes poètes. Dans un des jeunes cénacles dont je faisais partie, et où on faisait largement honneur aux spiritueux, il était de rite de s’agenouiller tous ensemble, et de réciter en chœur Les lithanies de Satan de Baudelaire, alors récemment traduites par le poète Stanislas Brzozowski. On se frappait la poitrine comme des derviches en extase tout on hurlant le refrain: „O, Satan, prends pitié de ma longue misère!” On lisait beaucoup Huysmans; plus d’un de nos jeunes décadents (comme on les appelait à cette époque) aurait volontiers imité la vie „à rebours” de des Esseintes, ci cela avait été moins coûteux.
Mais, si l’on parle de l’état des esprits de la jeune Pologne à l’égard de la littérature française, il faut bien distinguer: ceux qui connaissaient la langue et ceux qui ne la connaissaient pas. Les premiers étaient tous acquis à la France; les opinions des autres étaient plutôt confuses. La connaissance de la langue française se perdait chez nous; à mesure que surgissaient de nouvelles couches démocratiques, elle devenait un luxe. On nous tourmentait beaucoup au collège avec le grec; on nous bourrait de la langue et de la littérature allemande... Or, ceux qui ne possédaient pas la langue française étaient quasi-matériellement séparés de la France, n’en pouvaient avoir qu’une très faible idée, surtout de sa grande littérature. Car, par un paradoxe assez curieux, nous avons toujours eu assez peu de traductions de français, par le fait même de la diffusion séculaire de cette langue chez nous. Prenons un exemple: nous n’avons jamais eu de traduction de la Nouvelle Héloïse. A l’époque ou, comme veut la légende, le roi Stanislas-Auguste, après son avènement au trône, écrivait à Mme Geoffrin: Arrivez, maman, votre fils est loi, — on n’avait pas besoin chez nous de traductions. De même Mme Hańska, pour faire sa déclaration à Balzac, n’a pas attendu les traducteurs. Fait curieux: dans la période de la plus vive gloire de Balzac, 1840–1880, nous n’avons pas eu de ses traductions. Mais successivement, quand la connaissance de la langue française commença à se perdre, cet état devint très dangereux pour le rayonnement de la pensée française.
Je devins donc docteur en médecine. Bientôt je me retrouvai à Paris, où je devais me perfectionner dans l’art médical.
C’est à peine si je mis les pieds dans les cliniques. C’était, je crois, aux cours de M. Dieulafoy et de M. Hayem. Mais je sentis aussitôt que, me trouvant à Paris, dans cette ville unique, ce serait folie que de perdre mon temps à percuter les poumons et à tâter les foies absolument identiques à ceux que j’avais laissés dans mon pays. Alors j’envoyai promener les hôpitaux et les laboratoires et tout bonnement je me mis à flâner au hasard.
Je ne trouve rien, à quoi je pourrais comparer l’impression de cette première rencontre. Il y a dans cette ville comme un fluide mystérieux qui se dégage des murs, des rues, de la foule, de l’air. Cette impression est si forte, si enivrante, que les nerfs de beaucoup de gens se trouvent ébranlés par ce premier contact avec Paris; c’est comme une crise aiguë, suivie d’une prostration. Moi aussi, j’ai subi cette attaque de „neurasthénie parisienne”. Affolé, énervé, presque malade, je me suis enfermé dans ma petite chambre d’étudiant — c’était un petit hôtel de la rue Bonaparte — et l’hiver étant dur, je restais presque tout le temps dans mon lit, ayant pris un abonnement dans un cabinet de lecture. Je suis tombé sur un livre de Balzac, auteur que je ne connaissais presque pas: c’étaient, par hasard, Les Illusions perdues. J’ai dévoré de suite toute La Comédie humaine. Alors seulement je fus vacciné contre Paris, je pouvais me promener dans les rues. Cette lecture de Balzac en plein Paris inconnu, qu’accompagnaient les rumeurs de l’immense ville arrivant du dehors, me procura quelques semaines que je crus passer dans un rêve. Le soir, quand il fallait quitter la chambre pour prendre quelque nourriture, je parcourais la ville vivant encore dans la magie de la Comédie humaine.
Et puis, les quais de la Seine! Je connus la volupté de ces promenades qui durent des heures, de ces langueurs en présence du plus beau paysage du monde, de ce paysage de pierre du vieux Paris depuis Notre-Dame jusqu’au Louvre, tout en furetant dans les boîtes aux livres le long des Quais...
Après Balzac, vint Diderot, dont Jacques le fataliste et son maître m’intrigua d’abord sur les quais par son titre bizarre. Cela me fit faire le tour du XVIII-e siècle. Et c’est là, sur les quais, que j’ai suivi, en quelque façon, le cours de la littérature française; c’est d’ailleurs le seul que j’aie suivi. Je n’ai fait que m’extasier devant les murs vénérables de la Sorbonne, du Collège de France, fasciné par la force mystérieuse qu’elles recèlent. Mais je n’y ai jamais mis les pieds. J’étais timide, je ne savais pas par où l’on entre, et puis, le principal, j’étais venu à Paris pour étudier la médecine.
Mais autre chose devait me solliciter si fortement que ma carrière s’en trouva changée. Je veux parler de la chanson, de la chanson parisienne. De cette chanson, je fus vaguement épris des les premiers jours passés à Paris. C’était exotique pour moi: chez nous on ne chantait pas. Je rencontrais cette chanson un peu partout. Dans la rue je stationnais volontiers dans les groupes qui entouraient un chanteur ambulant. Puis, à mon étonnement, je vis des boutiques à chansons, où l’on vendait des chansons comme des petits-pains et où un gramophone d’une patience à toute épreuve enseignait au public la chanson du jour. J’entendais avec plaisir chanter les jeunes filles que j’avais connues au Bal Bullier. Mais les vraies sources de la chanson parisienne m’étaient inconnues. Certes, les échos des glorieux succès du Chat-Noir étaient arrivés jusqu’à Cracovie, mais pour moi, jeune sauvage, seul, perdu dans cet immense Paris, ahuri, je n’ai pas eu l’idée d’en demander des nouvelles; le



Uwagi (0)